dimanche, 08 novembre 2015
La Civiltà Cattolica, le Père Spadaro, le Pape François et la communion des personnes divorcées remariées
“Le synode a posé les bases de l’accès aux sacrements des divorcés-remariés” confirme le Père Spadaro, jésuite proche du pape François.
— Jean-Marie Guénois (@jmguenois) 8 Novembre 2015

Le Père Spadaro est-il vraiment si proche du Pape François ? Toute la question est là. N'oublions pas que lorsque Bergoglio était Cardinal, il ne se rendait jamais à la maison générale des Jésuites (cf. biographie de Austen Ivereigh). C'est une fois devenu Pape qu'il a voulu tendre une main fraternelle et miséricordieuse.
Trois précisions:
Premièrement, le deux synodes ne vont pas dans ce sens.
Deuxièmement, il y a bien une lutte et un combat interne à l'Eglise catholique, qui se répercutent médiatiquement. La Civiltà Cattolica, certes prestigieuse Revue théologique, n'est pas non plus un organe du Magistère. Les médias mettent une pression pour déterminer les thèmes que l'opinion publique évoque, en créant un certain climat médiatique. Mais la décision n'est pas du ressort de la communication.
Finalement, c'est plutôt l'Esprit-Saint qui est la Personne la plus proche du Pape François. La plus grande oeuvre de Miséricorde est sans doute l'effet que la Vérité opère dans l'âme humaine.
Attendons avec patience l'exhortation apostolique du Pape. Il est certain que le Pape va au devant de grandes souffrances. Comme il le demande si souvent: prions pour lui.
23:05 | Lien permanent | Commentaires (0) | | | ![]() Facebook
Facebook
Luc Recordon aurait-il préféré ne pas être élu ?
Luc Recordon, homme politique avec un handicap, n'est pas réélu
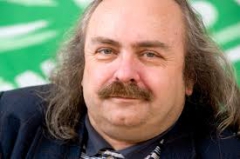 Il y a des phrases qui ne peuvent jamais être dites, car impensables, même si concevables, notamment dans la souffrance.
Il y a des phrases qui ne peuvent jamais être dites, car impensables, même si concevables, notamment dans la souffrance.
Par exemple: quelle joie que Luc Recordon soit enfin mort à la politique fédérale !
Pourtant, l'écologiste non-réélu ce dimanche, avait eu ces mots à glacer le sang:
«J’en appelle à vous au nom de ces enfants qui, comme moi, auraient préféré ne pas naître.»
Luc Recordon, en faveur du diagnostique préimplantatoire 2005
Pourtant l'une et l'autre sont mortifères, violentes, fort blessantes, inhumaines, inconvenantes et intolérables. Comment se fait-il que cette dernière fut si médiatisée ?
18:53 | Lien permanent | Commentaires (3) | | | ![]() Facebook
Facebook
Le Pape François s'exprime sur Vatileaks 2: la publication est une infraction, un acte déplorable

Le Pape François parle de Vatileaks 2
"Faire publier ces documents a été une infraction, un délit. C'est un acte déplorable qui n'aide pas".
"C'est moi-même qui ait demandé cette étude et ces documents, moi et mes collaborateurs ont les connaissait déjà".
Angélus, 8 novembre 2015
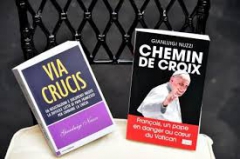
Vatican - le 08/11/2015 à 12:56:00 Agence I.Media
Vatileaks : Malgré la publication “déplorable“ de documents confidentiels, assure le pape, la réforme des finances se poursuit
Trois jours après la publication de livres à sensation sur des dérives financières et la gabegie au Vatican, le pape François a assuré aux fidèles qu’il entendait bien poursuivre son “travail de réforme“, le 8 novembre 2015, lors de la prière de l’Angélus. Volontiers rassurant, le chef de l'Eglise catholique a invité les fidèles à ne pas se laisser “perturber“ par ces affaires, soutenant également que le vol et la publication de documents confidentiels constituaient un “acte déplorable“ et “un délit“.
Le pape n’a pas tardé à réagir publiquement à la sortie de deux ouvrages très médiatiques sur la gabegie, la corruption et les dérives financières supposés au Vatican, et après la mise en cause d’un prélat et d’une laïque soupçonnés d’avoir volé des documents confidentiels pour les transmettre aux auteurs de ces livres. “Je sais que nombre d’entre vous ont été perturbés par les informations diffusées ces derniers jours à propos de documents confidentiels du Saint-Siège qui ont été volés et publiés“, a ainsi affirmé le pape François avant de poursuivre : “Pour cela, je voudrais surtout vous dire que voler ces documents est un délit. C’est un acte déplorable qui n’aide en rien“.
“J’avais demandé moi-même de faire ce travail et, mes collaborateurs et moi-même, nous les connaissions déjà bien“, a assuré le pape, en référence au travail lancé dès juillet 2013 à sa demande par la Commission pour la réorganisation des services économico-administratifs du Vatican (COSEA). “Des mesures ont été prises qui commencent à porter leurs fruits, dont certains sont déjà visibles“, a encore soutenu le chef de l’Eglise catholique.
La réforme se poursuit
“Je veux également vous dire que ce triste événement ne me détourne certainement pas du travail de réforme que nous effectuons avec mes collaborateurs, et avec le soutien de vous tous“, a poursuivi le pape, interrompu par les applaudissements des milliers de fidèles présents place Saint-Pierre.
“Oui, avec le soutien de toute l’Eglise, parce que l’Eglise se renouvelle avec la prière et avec la sainteté quotidienne de chaque baptisé“, a encore lancé le pape avant de conclure : “Je vous remercie donc et je vous demande de continuer à prier pour le pape et pour l’Eglise, sans vous laisser perturber, mais en allant de l’avant avec confiance et espérance“.
Auparavant, dans sa catéchèse dominicale, le pape François avait évoqué l’évangile du jour et pointé du doigt trois défauts : la superbe, l’avidité et l’hypocrisie, mettant particulièrement en garde ceux qui séparent la prière de la justice.
Au terme de la prière de l’Angélus, le pape a souhaité saluer les représentants de l’ordre des prêcheurs, les dominicains, ayant ouvert la veille un jubilé pour les 800 ans de l’ordre (1216-2016). “Merci pour tout ce que vous faites dans et pour l’Eglise“, a alors lancé le pontife. Ce jubilé se conclura le 20 janvier 2017, lors d’une eucharistie à Saint-Jean-de-Latran que le pape pourrait célébrer. AMI
18:29 | Lien permanent | Commentaires (0) | | | ![]() Facebook
Facebook
Interview du Pape pour un journal des sans-abri
Une interview du Saint-Père à Straat Nieuws, le journal néerlandais des sans-abri
Cité du Vatican, 6 novembre 2015 (VIS).
 Straat Nieuws, le journal néerlandais des sans-abri, publie une interview du Pape, réalisée le 27 octobre, reprise par les 113 journaux du Réseau international des journaux de rue.
Straat Nieuws, le journal néerlandais des sans-abri, publie une interview du Pape, réalisée le 27 octobre, reprise par les 113 journaux du Réseau international des journaux de rue.
En voici quelques passages portant principalement sur la question de la pauvreté.
Quel est le message de l'Eglise pour les sans-abri? Qu'est-ce que la solidarité chrétienne pratique?
Le Pape: "Je pense à deux choses. Jésus est venu au monde sans même avoir un toit, et il est devenu pauvre. L'Eglise...sait ce que veut dire ne pas avoir un toit au-dessus de soi, alors que c'est un droit que défendent les Mouvements populaires des trois T (travail, toit, terre.) L'Eglise dit que toute personne a droit à ces trois T.
Vous demandez très souvent de prendre soin des pauvres et des réfugiés. N'avez-vous pas peur de lasser les media et la société en général?
Le Pape: "Lorsqu'il s'agit d'un sujet qui est pas agréable...on est effectivement tous tentés dire ça suffit. Oui. Si je me sens fatigué...je ne me préoccupe pas et continue à parler de la vérité et de dire les choses comme elles sont.''
N'avez-vous pas peur que votre appel à la solidarité envers les sans-abri et les pauvres soit exploité politiquement? Comment l'Eglise doit elle parler pour être influente tout en restant en dehors du débat politique?
Le Pape: "On risque de faire des erreurs dans ce domaine... L'Eglise doit dire la vérité mais aussi témoignage, le témoignage de la pauvreté. Si un croyant parle de la pauvreté ou des sans-abri alors qu'il vit comme un roi, ça ne va pas. L'autre risque est de conclure des accords avec les autorités politiques...peu clairs et transparents" qui favorisent la corruption présente dans la vie publique, mais aussi politique et religieuse".
Saint François, qui avait choisi la pauvreté radicale, vendit jusqu'à son évangéliaire. Comme Pape, ne vous sentez-vous pas encouragé à vendre les trésors de l'Eglise?
Le Pape: "Il ne s'agit pas des trésors de l'Eglise mais de toute l'humanité Par exemple, si demain je dis de mettre en vente la Pietà, on me répondra que ce n'est pas possible parce qu'elle n'appartient pas par l'Eglise. Elle est dans une église, mais appartient à l'humanité. Cela vaut pour tous les trésors de l'Eglise. Par contre nous avons commencé à vendre des cadeaux qu'on me fait."
Avez-vous vous conscience que la richesse de l'Eglise puisse créer de telles attentes?
Le Pape: "Oui. Si on dressait un inventaire des biens de l'Eglise, on pourrait croire qu'elle est très riche... En 1929, le gouvernement italien avait offert au Saint-Siège un vaste territoire, et c'est Pie XI qui a refusé et accepté seulement un demi-kilomètre carré de garantir l'indépendance de l'Eglise... Le parc immobilier de l'Eglise est important mais nous l'utilisons pour maintenir les structures de l'Eglise et réaliser de nombreux travaux, des hôpitaux ou des écoles. Par exemple, j'ai fait envoyer au Congo 50.000 euro pour construire trois écoles dans les zones défavorisées. L'éducation est une chose importante pour les enfants."
Très Saint Père, pouvez-vous imaginer un monde sans pauvres?
Le Pape: "Je voudrais un monde sans pauvres, et nous devons nous battre pour cela. Mais je suis un croyant et je sais que le péché est toujours en nous. Et il y a toujours la cupidité humaine, le manque de solidarité, l'égoïsme qui crée pauvres. Il est donc difficile d'imaginer un monde sans mal. Si on pense aux enfants exploités par le travail...ou les abus sexuels..., aux enfants tués pour le trafic d'organes! ... Je ne sais pas si on réussira à réaliser un monde un monde sans pauvres, parce que le péché est toujours là, qui conduit à l'égoïsme. Mais il faut continuer de lutter, toujours et encore."
-------
Vatican - le 06/11/2015 à 18:08:00 Agence I.Media
Une Eglise pauvre pour les pauvres : c’était le vœu du Pacte des catacombes, il y a 50 ans
 En écho au souhait du pape François de voir naître “une Eglise pauvre pour les pauvres“, l’Eglise catholique va commémorer un événement assez méconnu de son histoire : la signature, il y a 50 ans, du Pacte des catacombes par une quarantaine d’évêques s’engageant à la pauvreté évangélique, auxquels se sont ralliés par la suite plus de 500 pasteurs du monde entier. Pour cet anniversaire, un séminaire est organisé à l’Université urbanienne de Rome le 14 novembre 2015.
En écho au souhait du pape François de voir naître “une Eglise pauvre pour les pauvres“, l’Eglise catholique va commémorer un événement assez méconnu de son histoire : la signature, il y a 50 ans, du Pacte des catacombes par une quarantaine d’évêques s’engageant à la pauvreté évangélique, auxquels se sont ralliés par la suite plus de 500 pasteurs du monde entier. Pour cet anniversaire, un séminaire est organisé à l’Université urbanienne de Rome le 14 novembre 2015.
Le 16 novembre 1965, peu de jours avant la clôture du Concile Vatican II (1962-1965), une quarantaine de pères conciliaires signaient secrètement le Pacte des catacombes, s’engageant à “une vie de pauvreté“. Au terme d’une messe aux catacombes de Domitille dans le Sud de Rome, en s’appuyant sur l’Evangile et conscients de leurs “manques“ et de leurs “faiblesses“, les signataires se sont engagés à renoncer aux privilèges et à vivre “ordinairement“, que ce soit dans leur logement, leur alimentation, leurs moyens de locomotion ou encore leurs vêtements.
Deux mois avant cet évènement, Paul VI avait célébré la messe dans la catacombe auprès des tombeaux des premiers chrétiens, affirmant en particulier : “Ici l’Eglise fut dépouillée de tout pouvoir humain, ici elle fut pauvre, humble, pieuse, opprimée et héroïque“.
Dans ce pacte, les pasteurs, auxquels se rallièrent des centaines d’autres par la suite, renonçaient donc aux titres d’honneur, “à l’apparence et aux réalités de la richesse“, à posséder des biens immobiliers en leur nom propre, et même des comptes en banque. Afin de mieux se consacrer à la “pastorale“ et au “service“, ils exprimaient leur intention de confier la gestion financière et matérielle de leurs diocèses à “des laïcs compétents“. Enfin, les responsables ecclésiaux promettaient de se consacrer au service des personnes et des groupes “économiquement faibles et peu développés“, et d’interpeler les chefs de gouvernement, afin de promouvoir la lutte contre la misère et les inégalités.
Cinquante ans plus tard, le Pacte des catacombes demeure peu connu, mais il n’est pas encore tout à fait tombé dans les oubliettes. Il est cité parmi les initiatives qui ont influencé la Théologie de la libération. Par ailleurs, le seul des évêques signataires à être encore en vie, l’Italien Mgr Luigi Bettazzi, a appelé ses confrères à le relancer en l’honneur de ce jubilé. Un anniversaire qui, d’une certaine façon, rend hommage aux pasteurs catholiques qui s’efforcent de suivre la voie de la pauvreté évangélique, hier ou aujourd’hui, et que le pape François pourrait choisir de commémorer. AK
18:22 | Lien permanent | Commentaires (0) | | | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 07 novembre 2015
Synode des évêques pour la famille: le Père Thomas Michelet dans la Revue théologique Nova et Vetera

Que dit vraiment le synode sur les divorcés remariés ?

Note: le Père Michelet, depuis peu docteur en théologie, analyse les textes du Synode et explique les divergences d'interprétation (ou herméneutique) par "l'herméneutique de la continuité" (Benoît XVI parlait d'herméneutique de la réforme) et de "l'herméneutique de la rupture".
Ce texte synodal est provisoire et ne contient pas de fait le mot communion. Avec cette réalité, les passages délicats n'auraient d'ailleurs pas eu les 2/3 des voies. La difficulté provient sans doute de là.
Le Pape François pourra s'appuyer sur ce labeur synodal, qui par deux fois n'a pas changé l'enseignement de l'Eglise (Vetera), toujours ouvert sur la Miséricorde. La nouveauté (Nova) provient du ton rempli de compassion et de miséricorde, qui rendent la vérité attrayante. "L'hérméneutique de la réforme" devient encore plus clairement celle de la Miséricorde. C'est une authentique théologie de la libération.
par Thomas Michelet O.P.
Il n’aura échappé à personne que la question des "divorcés remariés" (que l’on devrait plutôt appeler "séparés-réengagés") aura été la plus âprement discutée tout au long de ce synode sur la famille, tant parmi les pères synodaux que chez les fidèles, et jusque dans le grand public – faisant même régulièrement la "une" des journaux, ce qui ne s’était pas vu depuis longtemps. Peu de questions auront finalement suscité autant d’intérêt que celle-là.
La complexité du débat se traduit dans les documents officiels, les points directement concernés étant ceux qui ont recueilli à chaque fois le moins de votes positifs, malgré des rédactions successives en vue d’obtenir un large consensus. Mais cela se retrouve également dans les conclusions les plus contradictoires des médias, qui crient selon les cas à la victoire de l’un ou l’autre camp, que ce soit d’ailleurs pour s’en réjouir ou pour le déplorer : les uns retenant l’accès au cas par cas des divorcés remariés à la communion comme inaugurant la révolution tranquille d’une Église nouvelle ; les autres, au contraire, son absence criante dans le rapport final et donc le maintien ferme du "statu quo ante".
N’opposons pas trop vite le "synode des médias" au synode réel, et reconnaissons avec honnêteté que ce conflit d’interprétation trouve au moins en partie sa source dans la formulation elle-même du texte, qui sur ce point précis manque de la clarté et de la précision que l’on aurait pu souhaiter après deux ans de travaux. Comme nous l’avions prédit au mois de juillet sur www.chiesa, il est à craindre que nombre de Pères synodaux se soient satisfaits de ce point d’accord pour des raisons au fond très différentes, voire opposées, le texte autorisant plusieurs lectures et permettant de couvrir une division qui demeure malgré tout, et qui risquera dorénavant de s’accroître si l’on ne fait pas toute la lumière.
1. Un consensus difficile
 On se souvient que dans la "Relatio synodi" du 18 octobre 2014, le numéro 52 sur l’accès des divorcés remariés aux sacrements de la Pénitence et de l’Eucharistie et le numéro 53 sur la communion spirituelle avaient été largement rejetés, faute d’avoir obtenu la majorité des deux tiers, soit 122 sur 183 Pères synodaux (n° 52 : 104 placet / 74 non placet ; n° 53 : 112 placet / 64 non placet). Il faut ajouter celui sur la pastorale des personnes à orientation homosexuelle (n° 55 : 118 placet / 62 non placet). Pourtant ces numéros formellement écartés s’étaient trouvés maintenus dans le texte officiel servant de document de travail pour la suite du processus synodal, sans doute pour favoriser une franche discussion qui n’occulte aucune difficulté.
On se souvient que dans la "Relatio synodi" du 18 octobre 2014, le numéro 52 sur l’accès des divorcés remariés aux sacrements de la Pénitence et de l’Eucharistie et le numéro 53 sur la communion spirituelle avaient été largement rejetés, faute d’avoir obtenu la majorité des deux tiers, soit 122 sur 183 Pères synodaux (n° 52 : 104 placet / 74 non placet ; n° 53 : 112 placet / 64 non placet). Il faut ajouter celui sur la pastorale des personnes à orientation homosexuelle (n° 55 : 118 placet / 62 non placet). Pourtant ces numéros formellement écartés s’étaient trouvés maintenus dans le texte officiel servant de document de travail pour la suite du processus synodal, sans doute pour favoriser une franche discussion qui n’occulte aucune difficulté.
Dans l’"Instrumentum laboris" du 23 juin 2015, sous le titre "la voie pénitentielle", le numéro 122 reprenait le précédent numéro 52 en y ajoutant un numéro 123 qui ouvrait sur l’affirmation surprenante selon laquelle "un commun accord existe sur l’hypothèse d’un itinéraire de réconciliation ou voie pénitentielle". On a pu alors s’interroger sur un tel accord mystérieux. D’autant plus que la majorité des Pères synodaux réunis en 2015 semble avoir marqué plutôt une large réserve à son endroit, ce qui fait que l’hypothèse n’a pas été adoptée "in fine", au moins sous cet intitulé.
Dans la "Relatio synodi" du 24 octobre 2015, les numéros 84 à 86 exposent désormais une proposition pastorale nouvelle sous le titre de "Discernement et intégration". Le nombre des Pères synodaux ayant été porté à 265, la majorité des deux-tiers passée à 177 n’a été obtenue que difficilement sur ces trois numéros, jusqu’à une voix près (n° 84 : 187 placet / 72 non placet ; n° 85 : 178 placet / 80 non placet ; n° 86 : 190 placet / 64 non placet).
La "Relatio synodi" 2015 donne trois références magistérielles, toutes contenues dans le numéro 85, que l’on trouvait déjà dans la "Relatio synodi" 2014 ou dans l’"Instrumentum laboris" : "Familiaris consortio", n° 84 ; Catéchisme de l’Église catholique, n° 1735 ; Déclaration du 24 juin 2000 du Conseil pontifical pour les Textes législatifs. En revanche, le document du 14 septembre 1994 de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, qui était évoqué dans le n° 123 de l’"Instrumentum laboris", n’a pas été repris.
2. La citation de "Familiaris consortio"
Examinons tout d’abord la citation de "Familiaris consortio" n° 84 :
"Les pasteurs doivent savoir que, par amour de la vérité, ils ont l'obligation de bien discerner les diverses situations. Il y a en effet une différence entre ceux qui se sont efforcés avec sincérité de sauver un premier mariage et ont été injustement abandonnés, et ceux qui par une faute grave ont détruit un mariage canoniquement valide. Il y a enfin le cas de ceux qui ont contracté une seconde union en vue de l'éducation de leurs enfants et qui ont parfois, en conscience, la certitude subjective que le mariage précédent, irrémédiablement détruit, n'avait jamais été valide."
Ce texte est présenté ici comme "un critère global, qui reste la base pour l'évaluation de ces situations", tant pour le prêtre dont le devoir est "d'accompagner les personnes concernées sur la voie du discernement", que pour le fidèle, dans son propre "examen de conscience, au moyen de temps de réflexion et de repentance".
Si l’on parle de repentance, cela implique la nécessité de reconnaître ses fautes et son péché en vue d’en obtenir le pardon. Il n’est donc pas juste d’affirmer que toute notion de péché est écartée dans ce document. Il reste qu’elle n’est plus exprimée dans le titre de la proposition, qui ne parle plus directement de pénitence mais de discernement ; ce que l’on peut regretter au plan doctrinal même si c’est certainement plus sympathique au plan pastoral. D’autre part, il est possible que l’on ait tendance à comprendre la repentance davantage pour des fautes du passé (l’Église faisant repentance pour les péchés de ses membres), tandis que la pénitence vise plus habituellement des situations passées aussi bien que présentes (et même le péché d’autrui), afin d’obtenir la conversion du pécheur et la réparation du mal causé par sa faute. Le choix du mot "repentance" risque donc de conduire à ne considérer le remariage après divorce que comme une faute du passé plutôt qu’une "situation objectivement désordonnée" toujours actuelle, voire à ne plus examiner que les fautes du passé qui auraient conduit à cette situation jugée non voulue pour elle-même et dès lors non fautive. À l’égard de ce processus, tant dans sa compréhension que dans sa pratique, il faut donc savoir faire preuve d’un véritable "discernement sémantique".
D’autre part, "Familiaris consortio" n° 84, tout en rappelant la nécessité de distinguer ces diverses situations, en tirait une même conclusion dans tous les cas : l’impossibilité de communier, à moins d’avoir "régularisé" sa situation, d’une manière ou d’une autre :
"L'Église, cependant, réaffirme sa discipline, fondée sur l'Écriture Sainte, selon laquelle elle ne peut admettre à la communion eucharistique les divorcés remariés. Ils se sont rendus eux-mêmes incapables d'y être admis car leur état et leur condition de vie est en contradiction objective avec la communion d'amour entre le Christ et l'Église, telle qu'elle s'exprime et est rendue présente dans l'Eucharistie. Il y a, par ailleurs, un autre motif pastoral particulier : si l'on admettait ces personnes à l'Eucharistie, les fidèles seraient induits en erreur et comprendraient mal la doctrine de l'Église concernant l'indissolubilité du mariage.
"La réconciliation par le sacrement de pénitence – qui ouvrirait la voie au sacrement de l'Eucharistie – ne peut être accordée qu'à ceux qui se sont repentis d'avoir violé le signe de l'Alliance et de la fidélité au Christ, et sont sincèrement disposés à une forme de vie qui ne soit plus en contradiction avec l'indissolubilité du mariage. Cela implique concrètement que, lorsque l'homme et la femme ne peuvent pas, pour de graves motifs – par l'exemple l'éducation des enfants – remplir l'obligation de la séparation, 'ils prennent l'engagement de vivre en complète continence, c'est-à-dire en s'abstenant des actes réservés aux époux'".
Que conclure de la non-reprise explicite de cette conclusion pourtant massive de "Familiaris consortio" par le document ?
Dans une "herméneutique de la continuité", on tiendra que le silence vaut accord, que la citation d’un texte renvoie au texte en son entier, lequel fournit à la citation son vrai contexte. De sorte qu’un tel processus de discernement ne peut conduire à l’Eucharistie que dans la mesure où le fidèle est effectivement parvenu à sortir de cette situation objectivement désordonnée au titre d’un engagement tenu par un ferme propos, qu’il a pu ainsi demander pardon de ses fautes et en recevoir enfin l’absolution. Jusque là, il ne saurait communier.
Dans une "herméneutique de la rupture", on tiendra que le silence vaut désaccord. Si la conclusion de "Familiaris consortio" n’est pas reprise expressément, c’est qu’elle est devenue obsolète ; le contexte familial ayant été complètement modifié depuis, au terme d’un changement dont le document dit qu’il est non seulement culturel mais "anthropologique". Ce qui était la discipline de l’Église du temps de Jean-Paul II ne devrait plus l’être dans l’Église nouvelle que l’on appelle de ses vœux. On conclura probablement que ce processus de discernement peut aboutir à l’Eucharistie, même sans changement de vie, pourvu que l’on ait fait repentance des fautes passées et qu’on ait discerné que l’on pouvait "en conscience" communier.
3. Le Catéchisme de l’Église catholique
Le même numéro 85 de la "Relatio synodi" 2015 cite plus loin le n° 1735 du Catéchisme de l’Église catholique :
"En outre, on ne peut nier que, dans certaines circonstances, 'l’imputabilité et la responsabilité d’une action peuvent être diminuées voire supprimées' (CEC, 1735) en raison de divers conditionnements".
La citation est incomplète. Il faut se reporter au texte en son entier :
"1735. L’imputabilité et la responsabilité d’une action peuvent être diminuées voire supprimées par l’ignorance, l’inadvertance, la violence, la crainte, les habitudes, les affections immodérées et d’autres facteurs psychiques ou sociaux".
Ce numéro est-il vraiment applicable à la situation des divorcés remariés ? Il faut d’abord noter que les mêmes conditions se retrouvent en partie pour le mariage, qui le rendent invalide :
"1628. Le consentement doit être un acte de la volonté de chacun des contractants, libre de violence ou de crainte grave externe (cf. CIC, can. 1103). Aucun pouvoir humain ne peut se substituer à ce consentement (CIC, can. 1057, § 1). Si cette liberté manque, le mariage est invalide".
Peut-on alors imaginer que telles circonstances puissent rendre non imputable au plan moral le remariage après divorce ? Si tel était le cas, il serait par conséquent invalide. Certes, il l’est déjà parce que, le mariage étant indissoluble, il ne saurait y avoir de remariage du vivant de son conjoint. Mais il ne serait pas seulement nul en tant que mariage : il le serait aussi en tant qu’acte humain, ce serait un "acte manqué". On ne pourrait donc plus parler de divorcés remariés : il n’y aurait donc aucun réengagement véritable, et plus aucune espèce de lien entre les deux. Dans ces conditions, il n’est pas sûr que l’on veuille toujours faire valoir la possibilité d’une suppression totale de l’imputabilité. D’ailleurs, de tels conditionnements psychiques devraient d’abord conduire à remettre en question l’existence du lien sacramentel lui-même. La situation serait alors toute différente.
À l’inverse, lorsque les personnes sont capables d’échanger un "oui" pour la vie en pleine conscience de ce qu’elles font, elles ne peuvent pas ne pas se rendre compte qu’elles portent atteinte à ce "oui" en s’engageant de nouveau avec une autre personne. Dès lors, on voit mal comment la responsabilité de cet acte de réengagement pourrait être remise en cause. Certes, il peut y avoir toutes sortes de raisons qui poussent à agir ainsi, comme le dit ensuite le numéro 85 : "Dans certaines circonstances, les gens trouvent qu'il est très difficile d'agir différemment". Il n’empêche que ou bien ils savent qu’ils portent atteinte à leur lien matrimonial en se réengageant, et il s’agit là d’un acte libre et responsable ; ou bien ils ne le savent vraiment pas, et l’on peut alors douter de l’existence même de leur lien matrimonial.
4. La Déclaration du Conseil pontifical pour les Textes législatifs
L’article 85 de la "Relatio synodi" 2015 poursuit ainsi :
"En conséquence, le jugement d'une situation objective ne doit pas conduire à un jugement sur la 'culpabilité subjective' (Conseil pontifical pour les Textes législatifs, Déclaration du 24 Juin 2000, 2a)".
Le texte en question est le suivant, remis dans son contexte :
"2. Toute interprétation du canon 915 qui s’oppose à son contenu substantiel, déclaré sans interruption par le Magistère et par la discipline de l’Église au cours des siècles, est clairement déviante. On ne peut confondre le respect des mots de la loi (cf. canon 17) avec l’usage impropre de ces mêmes mots comme des instruments pour relativiser ou vider les préceptes de leur substance.
"La formule 'et ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste' est claire et doit être comprise d’une façon qui n’en déforme pas le sens, en rendant la norme inapplicable. Les trois conditions suivantes sont requises :
"a) le péché grave, compris objectivement, parce que de l’imputabilité subjective le ministre de la communion ne peut juger ;
"b) la persistance obstinée, ce qui signifie qu’il existe une situation objective de péché qui perdure au cours du temps et à laquelle la volonté des fidèles ne met pas fin, tandis que d’autres conditions ne sont pas requises (attitude de défi, monition préalable, etc.) pour que la situation soit fondamentalement grave du point de vue ecclésial ;
"c) le caractère manifeste de la situation de péché grave habituel.
"Par contre ne sont pas en situation de péché grave habituel les fidèles divorcés remariés qui, pour des raisons sérieuses, comme par exemple l’éducation des enfants, ne peuvent 'satisfaire à l’obligation de la séparation, et s’engagent à vivre en pleine continence, c’est-à-dire à s’abstenir des actes propres des conjoints' (Familiaris consortio, numéro 84), et qui, sur la base d’une telle résolution, ont reçu le sacrement de la pénitence. Puisque le fait que ces fidèles ne vivent pas 'more uxorio' est en soi occulte, tandis que leur condition de divorcés remariés est en elle-même manifeste, ils ne pourront s’approcher de la communion eucharistique que 'remoto scandalo'".
Cette Déclaration du Conseil pontifical pour les Textes législatifs établit donc que le remariage après divorce est une situation de "péché grave habituel", ce que le canon 915 vise au titre de "ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste". Le passage cité par la "Relatio synodi" précise que cette qualification s’entend objectivement et non pas subjectivement, "parce que de l’imputabilité subjective le ministre de la communion ne peut juger". Autrement dit, on apprécie la situation au for externe, n’ayant pas accès au for interne. Or dans le contexte de la "Relatio synodi", ce passage semble prendre un autre sens : on ne peut juger sur la "culpabilité subjective", et donc il faudrait s’abstenir de qualifier cette situation moralement. Certes, le texte ne conclut pas cela expressément, mais si l’on ne prend pas la peine de se reporter au texte de la Déclaration, on peut le comprendre ainsi. Et d’ailleurs, le texte ne dit nulle part qu’il s’agit d’un péché, ni que le Christ désigne comme un adultère le remariage du vivant de son conjoint (cf. Mc 10, 11-12). Cette parole peut être dure à entendre, mais elle se trouve bien dans la bouche du Christ, qui en mesure toute la portée.
Là encore, une "herméneutique de la continuité" conduira à interpréter ce texte en précisant ce qu’il ne dit pas et en maintenant la qualification de "péché grave et manifeste" ; tandis qu’une "herméneutique de la rupture" prendra appui sur ce silence pour s’en tenir à l’abstention de juger au plan de la culpabilité subjective, ce qui conduira à écarter toute qualification de cette situation en termes de péché, qu’il soit grave et manifeste ou non.
Dans le premier cas, on tiendra donc, à la lumière de "Veritatis splendor", que le remariage après divorce est un acte mauvais que nul ne peut jamais vouloir, quelles que soient les circonstances, dans une morale de l’objectivité et de la finalité. Dans le second cas, on retiendra l’invitation à convertir son regard pastoral et à tenir compte davantage des circonstances, donc à modifier l’équilibre doctrinal de "Veritatis splendor" en faisant appel à une morale de la subjectivité et de la conscience. Le pape a garanti que l’on n’avait jamais touché à la doctrine, ce qui va dans le premier sens. De fait, il y a suffisamment de références au magistère pour conforter les tenants de l’herméneutique de la continuité dans leur lecture. Mais il y a aussi suffisamment de silence et de signaux positifs pour que les tenants de l’herméneutique de la rupture se sentent justifiés dans leur approche nouvelle. En l’absence de précisions supplémentaires, les deux interprétations semblent permises.
En conclusion de ces trois citations, de telles lacunes dans la formulation expliquent sans doute que ce numéro 85 ait recueilli le plus de non placet et qu’il n’ait été voté qu’à une seule voix de majorité. Mais il est possible que davantage de précisions dans un sens ou dans un autre lui auraient fait perdre un peu plus de voix ; une seule aurait suffi pour le rejeter.
5. Accompagnement et intégration
Le numéro 84 présente quant à lui la "logique de l'intégration" des divorcés remariés comme la "clef de leur accompagnement pastoral", visant à manifester non seulement qu’ils ne sont pas excommuniés, mais qu’ils peuvent vivre et grandir dans l’Église, en surmontant les "différentes formes d'exclusion pratiquées actuellement dans le cadre liturgique, pastoral, éducatif et institutionnel". Le numéro 86 place enfin le "jugement correct sur ce qui fait obstacle à la possibilité d'une plus grande participation à la vie de l'Église" au plan du discernement avec le prêtre au for interne ; "ce discernement ne pourra jamais manquer aux exigences de la vérité et de la charité de l'Évangile proposées par l'Église".
Interprétés dans le cadre d’une "herméneutique de la continuité", ces deux numéros apparaissent parfaitement orthodoxes et conformes au magistère récent. Le rappel de "Familiaris consortio" n° 84 et de la Déclaration du Conseil pontifical pour les Textes législatifs permet de comprendre cette croissance comme une conversion progressive à la vérité évangélique dont on s’efforcera de traduire progressivement dans sa vie toutes les exigences. Une pastorale de l’accompagnement devra toujours viser la pleine réconciliation du fidèle et sa réadmission finale à l’Eucharistie, moyennant les conditions énoncées par "Familiaris consortio" n° 84 pour mettre fin à la "contradiction objective avec la communion d'amour entre le Christ et l'Église" que représente le réengagement avec une autre personne que son conjoint légitime, et que le Code de Droit canonique qualifie au for externe de "péché grave et manifeste".
Il y a là un véritable chemin de sainteté, esquissé d’une belle manière par la fin du numéro 86, qui parle des "nécessaires conditions d'humilité, de confiance, d'amour de l'Église et de son enseignement, dans la recherche sincère de la volonté de Dieu et le désir de parvenir à une réponse plus parfaite". La reconnaissance de l’intégration dans l’Église se faisant alors au titre de "l’ordre des pénitents", comme on aurait dit jadis, avec des limites dans l’exercice des différentes fonctions ecclésiales qui se comprennent en fonction de l’objectivité de la situation désordonnée, et qui peuvent être levées à proportion de la régularisation de cette situation.
En revanche, dans le cadre d’une "herméneutique de la rupture", ces conditions et conclusions du magistère antérieur étant passées sous silence dans ce texte, on aura tendance à privilégier la relative nouveauté que représente la valorisation du for interne, au détriment du for externe. On aboutira alors à une morale de la subjectivité, plutôt que de l’objectivité, avec la difficulté d’admettre avec "Veritatis splendor" la possibilité d’"actes intrinsèquement pervers" ; l’accent étant mis surtout sur la conscience et la perception intérieure des différentes actions, décisions et circonstances. Dans ces conditions, peu importe que le Code de Droit canonique qualifie cette situation de "péché grave et manifeste", lorsqu’elle n’est pas perçue comme telle intérieurement. Et même, il vaudrait mieux le taire, plutôt que d’empiéter sur l’espace intérieur de la liberté et le sanctuaire inviolable de la conscience.
On attendra donc que la personne soit en mesure de qualifier par elle-même ces actes, sans jamais intervenir dans le processus, de peur de la blesser ou d’en forcer la libre progression. Il s’agit plus ici d’une "liberté d’indifférence" que d’une "liberté de qualité". L’accompagnement se faisant alors à partir de la personne et de ce qui, en elle, peut être mis en valeur pour la faire grandir, plutôt qu’à partir d’une loi imposée de l’extérieur à laquelle elle devrait se conformer. L’intégration dans l’Église étant fonction de la subjectivité de la personne et de sa perception intérieure de sa propre situation. Dans ces conditions, si elle décide "en conscience" qu’elle n’a pas commis de péché et qu’elle peut communier, qui sommes-nous pour la juger ? Le progrès spirituel pouvant se traduire ensuite paradoxalement par un mouvement de retrait à mesure de la perception de son péché ou du désordre objectif : prenant la décision de ne plus communier parce qu’elle en comprend seulement alors la raison ; renonçant à certaines tâches dans l’Église parce qu’elle en comprend seulement alors le possible contre-témoignage public, eu égard à "l’exemple qu’elle offre aux jeunes qui se préparent au mariage".
Ces deux logiques sont présentées ici en opposition, il n’est cependant pas exclu qu’il puisse se trouver dans l’une et l’autre des aspects positifs et des limites, d’où l’intérêt de les mettre en perspective ; l’erreur elle-même pouvant servir à manifester davantage la vérité. La limite de la pure logique de l’objectivité se trouvant dans la considération qu’il faut du temps et des étapes pour aller à la vérité, pour que cette vérité soit accueillie non seulement comme vraie en soi mais vraie pour soi, désirable et bonne, et finalement possible à vivre et fructueuse. La limite de la pure logique de la conscience se trouvant dans l’affirmation de la possibilité d’une conscience erronée, et dans la nécessité évangélique de la libérer de cette erreur, pour qu’elle devienne ce qu’elle est, effectivement libre, en acte et pas seulement en puissance : "Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera" (Jn 8, 32).
Notons pour finir une certaine inquiétude sur le vocabulaire du numéro 84 qui oppose "exclusion" à "intégration". Ce n’est pas un vocabulaire habituel en théologie. En revanche, il est typique de l’idéologie égalitariste qui anime en particulier les mouvements LGBT et le libérationisme en général sur un vieux fond de dialectique marxiste, avec une tendance nouvelle nihiliste. Ce n’est plus la lutte des classes, mais l’abolition de toutes classes, différences, catégories, statuts… et donc la disparition de la vraie justice qui accorde à chacun selon sa part ("suum cuique tribuere"), qui n’est pas nécessairement la même pour tous, car les situations ne sont pas nécessairement les mêmes. Si l’on commence à admettre ce genre d’opposition mondaine dans un document ecclésiastique, c’est la porte ouverte à d’autres catégories de populations (personnes à tendance homosexuelles, femmes par rapport au clergé masculin, etc.) qui viendront se plaindre de leur "exclusion" pour revendiquer leur pleine "intégration" dans l’Église. Il serait donc judicieux d’exprimer autrement le souci de communion à l’égard de ceux qui ne sont pas actuellement en pleine communion avec l’Église, du fait d’une situation objectivement désordonnée qui rend impossible leur admission à l’Eucharistie, et de réaffirmer plutôt la charité qui nous presse de tout faire pour les conduire en vérité à la pleine communion ecclésiale, dans la conformité aux exigences évangéliques.
6. Communion et décentralisation
La "Relatio synodi" n’a aucune valeur magistérielle en tant que telle, elle n’est qu’un document adressé au Pape pour qu’il prenne lui-même une décision. On peut donc espérer que dans une exhortation apostolique post-synodale, le Pape détermine clairement la ligne à tenir. Ou bien qu’un document de la Congrégation pour la doctrine de la foi apporte les précisions nécessaires, par exemple sous forme de rappel de la juste interprétation des documents magistériels, selon une herméneutique de la continuité.
À défaut, que pourrait-il se passer ? Chacun va pouvoir rentrer chez soi satisfait, dans la certitude d’avoir obtenu ce qu’il voulait et évité le pire que réclamait le camp adverse. Or un accord obtenu sur fond d’ambiguïté ne fait pas une unité : il couvre plutôt une division. Les pratiques pastorales déjà existantes pourront continuer à exister et à se développer, les unes sur fond d’herméneutique de la continuité et les autres sur fond d’herméneutique de la rupture. Le renvoi à la décision pastorale de chaque prêtre et du fidèle "en conscience" permettra d’établir, document à l’appui, une grande variété de solutions pastorales, les unes pleinement conformes à l’orthodoxie et à l’orthopraxie, les autres plus discutables.
À terme, si dans un pays les prêtres encouragés par les "lignes directrices" de leurs évêques finissent par établir des pratiques pastorales identiques, mais divergentes de celles d’autres pays, cela pourrait aboutir à un schisme de fait, légitimé de chaque côté par une double lecture possible de ce document. On arrive donc à ce que nous avions déjà présenté en juillet comme une situation à craindre, si le synode ne parvenait pas à tracer une ligne claire. Nous y sommes.
En la fête des Apôtres S. Simon et S. Jude
28 octobre 2015
12:35 | Lien permanent | Commentaires (0) | | | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 06 novembre 2015
Vatileaks: Chouaqui est enceinte
 Vatileaks 2: Francesca Chaouqui est enceinte
Vatileaks 2: Francesca Chaouqui est enceinte
Selon Vatican Insider, Francesca Chaouqui n'est pas incarcérée car enceinte. Son état n'est donc pas compatible avec une arrestation.
Par contre, Mgr Lucio Vallejo Balda, qui ne dépend pas de l'Opus Dei si ce n'est spirituellement, est interrogé par les enquêteurs.
Les versions de Chaouqui et du prélat ne correspondent pas entre elles. Selon l'ancien secrétaire, c'est Chaouqui qui avaient les contacts avec les journalistes. Par contre, Mgr Lucio a bel et bien enregistré les conversations avec le Pape.
11:16 | Lien permanent | Commentaires (0) | | | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 05 novembre 2015
Vatileaks 2 et l'argent

Vatileaks 2, Nuzzi: ne pas prendre les lecteurs pour des cons !
Le susbstitut de la secrétairerie d'Etat Mgr Becciu et le Père Lombardi l'ont déclaré urbi et orbi: les affaires "révélées" par les deux livres sortis en librairie appartiennent au passé et étaient déjà connues.
"il s'agit d'informations déjà connues, certes avec bien moins d'ampleur et de détails"
Père Lombardi
Dans ces deux publications, il n'y a pas toute la vérité et rien que la vérité. La vérité, les faits, voilà ce qui intéressent les journalistes et les lecteurs.
Une simple question: combien vont gagner les deux journalistes ? Pour des livres qui sont ni totalement vrais, ni totalement faux, mais vagues, imprécis, partiaux et sensationnels ? En ce temps de crise économique, avec des personnes qui cherchent du travail et un logement, c'est l'hôpital qui se fiche de la charité.

Vatileaks 2: l'arroseur arrosé
C'est le paradoxe de ce Vatileaks 2: une dénonciation des finances du Vatican va engendrer un joli pactole aux auteurs. Se faire du fric sur la dénonciation d'irrégularités, avec des informations partielles obtenues de façons irrégulières, c'est agir de la même manière de ce qui est dénoncé.
Le Pape François est aussi devenu un objet commercial, dans le sens qu'il se vent bien. On ne pas pas tirer sur son idole puisqu'on l'utilise aussi pour se faire de l'argent.
Si on est vraiment et résolument avec la réforme du Pape François (comme l'affirme Nuzzi), on n'agit pas comme ceux que l'on accuse. C'est bien à une conversion personnelle que François nous appelle, afin de ne pas tomber dans les magouilles et la corruption, qui puent !
Au fond magouilles financières et Nuzzi, c'est kif-kif bourricot. Je ne vais pas encore acheter ces deux livres; je n'ai tout simplement pas envie d'être pris pour un âne.

19:57 | Lien permanent | Commentaires (6) | | | ![]() Facebook
Facebook
Le Suisse Romain recommande:"l'inspecteur vous demande" par la troupe EnVie2+
La troupe EnVie2+
L'inspecteur vous demande

Samedi 7 novembre 20h30
et Dimanche 8 novembre 17h00

La troupe EnVie2+ composée d'une vingtaine de jeunes.
La pièce « Un inspecteur vous demande » de J.B. Prisetley au rythme du théâtre, de la vidéo, du chant, de la musique et la danse.
Association EnVie2+
c/o Alain Rihs Rte du Bon 10 CH – 1167
Lussy-sur-Morges
contact@envie2plus.ch
12-594491-7
18:07 | Lien permanent | Commentaires (0) | | | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 04 novembre 2015
Vatileaks 2: mise au point du Père Lombardi
Nouveau scandale de fuites de documents confidentiels au #Vatican https://t.co/bTiFaAp78g pic.twitter.com/oaWqAbRMbJ
— Aleteia (@AleteiaFR) 3 Novembre 2015

Mise au point du P.Lombardi
Cité du Vatican, 4 novembre 2015 (VIS). Voici des réflexions proposées par le Directeur de la Salle de Presse à propos de la reprise du débat médiatique sur les problèmes économiques du Saint-Père:
"La publication imminente de deux livres ayant pour sujet les institutions et les activités économico-financières du Saint-Siège attise la curiosité et provoque une multiplication de commentaires. Quelques observations sont nécessaires. D'abord, une bonne partie de ce qui est publié résulte d'une fuite d'informations et de documents confidentiels. Il s'agit donc d'une démarche illégale qui doit être punie avec détermination par les autorités judiciaires vaticanes.
Mais ce n'est pas ce dont nous voulons parler aujourd'hui, d'autant que l'argument est déjà l'objet d'une excessive attention. Réfléchissons plutôt au contenu des fuites. On peut déjà dire que pour la plupart d'entre elles, il s'agit d'informations déjà connues, certes avec bien moins d'ampleur et de détails. La documentation exposée est principalement liée à une collecte de données mise en mouvement par le Saint- Père lui-même, en vue de lancer une réflexion sur l'amélioration ou la réforme des structures administratives de l'Etat du Vatican et du Saint-Siège.
A cet effet, la Commission d'études et de propositions relatives aux structures économico-administratives avait été instituée par le Pape en juillet 2013. Son mandat rempli, la COSEA a été dissoute en février suivant. On ne peut parler d'informations obtenues contre la volonté du Pape ou des chefs des différents organismes et institutions, mais d'informations obtenues ou fournies avec la collaboration de ces institutions, afin de contribuer aux réflexions communes sur les réformes à projeter. Bien sûr, beaucoup d'informations de cette nature doivent être étudiées, perçues et interprétées avec prudence, équilibre et attention. D'autant que des lectures différentes sont souvent possibles à partir des mêmes données.
Par exemple, la situation du Fonds des retraites, sur lequel ont été exprimées des évaluations très différentes, certains évoquant avec inquiétude un profond déficit, tandis que d'autres fournissaient une lecture rassurante (communiqués officiels publiés par la Salle de Presse du Saint-Siège).
Il y a aussi le débat relatif aux objectifs et à l'utilisation des biens du Saint-Siège. Bien qu'effectivement considérables, ils sont destinés à soutenir les services gérés par le Saint-Siège ou les institutions qui lui sont liées, à Rome comme de part le monde. La propriété de ces biens est très variée, et tout le monde dispose les outils permettant de connaître leur histoire et leur évolution. Il est par exemple utile se s'informer sur les accords économiques passés entre l'Italie et le Saint-Siège dans le cadre des Accords du Latran, mais aussi sur les efforts déployés par Pie XI avec le concours d'experts et collaborateurs remarquables, afin de disposer d'une administration efficace, au point que la gestion du Vatican fut reconnue comme un exemple de sagesse et de clairvoyante, y compris sous l'aspect des investissements à l'étranger.
En ce qui concerne le Denier de saint Pierre, il est nécessaire de savoir qu'il est employé de manières variables, en fonction des situations et des priorités du Saint-Père, à qui les fidèles l'ont offert pour soutenir son ministère. Les pauvres de charité du Pape en faveur des pauvres sont certainement l'objectif essentiel. Mais les fidèles n'entendent pas contester au Pape la liberté d'évaluer par lui même les situations d'urgence ni la façon d'y répondre pour le bien de l'Eglise universelle. Or cela comprend également outre la charité du Pape, ses initiatives hors du diocèse de Rome, la diffusion de son enseignement pour les fidèles des parties du monde les plus pauvres, la Curie Romaine comme un instrument de son service, le soutien aux 180 missions diplomatiques pontificales, l'assistance aux Eglises locales dans le besoin, etc. L'histoire du Denier démontre tout cela avec clarté.
Régulièrement ces débats médiatiques refont surface, attisant curiosité ou polémique. Il faudrait faire preuve de sérieux pour approfondir ces situations délicates et les différents problèmes spécifiques. Cela permettrait de distinguer ce qui va bien, et qui est beaucoup plus courant que ce que disent les publications en cause: Des actions et démarches parfaitement licites et justifiées, des actes administratifs normaux, y compris le paiement des impôts dus.
Il faudrait distinguer cela des problèmes à corriger, des points obscurs à dissiper, des véritables irrégularités ou illégalités à éliminer. C'est précisément le travail délicat et complexe entrepris à la demande du Pape avec la création de COSEA, dont les recommandations sont précisément suivies: La réorganisation des dicastères économiques, la création du poste de Réviseur général, le bon fonctionnement des institutions chargées de la surveillance des activités économiques et financières, etc.
C'est là une réalité objective et incontestable. La publication en vrac d'une grande quantité d'informations de nature diverse, en grande partie liée à une phase du travail aujourd'hui dépassée, fait tendencieusement l'impasse sur l'évaluation objective des résultats atteints. Pire elle crée l'impression du contraire et fait croire que règne une confusion permanente, la non-transparence, voire même la poursuite d'intérêts individuels ou incorrects. En outre, cela ne rend pas justice au courage et à l'engagement avec lesquels le Pape et ses collaborateurs ont fait face et continuent à relever le défi que représente l'amélioration de l'utilisation des biens temporels au service du spirituel.
C'est pourtant ce qui devrait être le plus apprécié et encouragé par un travail journalistique correct, capable de répondre adéquatement aux attentes de l'opinion et aux exigences de la vérité. L'objectif de la bonne administration, de l'équité et de la transparence n'a pas changé. Il progresse sans incertitudes et selon le voeu du Pape François. Il ne manque pas de personnes au Vatican pour collaborer loyalement et avec énergie".
15:56 | Lien permanent | Commentaires (0) | | | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 03 novembre 2015
Le rapport final du Synode enfin en français
22:45 | Lien permanent | Commentaires (1) | | | ![]() Facebook
Facebook
Synode des évêques pour la famille: le document provisoire parle d'intégration et pas de communion
Les évêques divisés sur l’interprétation des textes du Synode.
Les évêques répercutent de manière différente le texte provisoire du Synode. Cependant, pour les personnes divorcées remariées, le texte parle bel et bien d’intégration et de participation à la vie de l’Eglise, et non pas de communion.
Pour le tout prochain document, une exhortation apostolique post-synodale, le Pape risque cependant de se retrouver bien seul. Il aura toutefois les deux synodes avec lui. Un Synode n’est que consultatif, toujours « avec et sous » Pierre. Surtout qu'ils n'existent aucun texte et aucune citation du Pape qui diraient le contraire de l'enseignement de l'Eglise.
Le Vatican dément des propos prêtés au pape sur l'accès des divorcés aux sacrements https://t.co/HH9BxQVZI6
— La Vie (@LaVieHebdo) 3 Novembre 2015

Discernement et intégration
84. Les baptisés qui sont divorcés et remariés civilement doivent être davantage intégrés dans les communautés chrétiennes, dans les différentes modalités possibles, évitant toute occasion de scandale. La logique de l'intégration est la clé de leur accompagnement pastoral, pour qu'ils sachent non seulement qu'ils appartiennent au Corps du Christ qui est l'Eglise, mais qu'ils peuvent en avoir une expérience joyeuse et féconde. Ce sont des baptisés, ce sont des frères et des sœurs, l'Esprit Saint déverse en eux dons et charismes pour le bien de tous.
Leur participation peut s'exprimer dans différents services ecclésiaux: il est donc nécessaire de discerner lesquelles, parmi les différentes formes d'exclusion pratiquées actuellement dans les domaines liturgique, pastoral, éducatif et institutionnel, peuvent être surmontées. Non seulement ils ne doivent pas se sentir excommuniés, mais ils peuvent vivre et grandir comme membre vivant de l'Eglise, la ressentant comme une mère qui les accueille toujours, prend soin d'eux avec affection et les encourage dans le chemin de la vie et de l'Evangile.
Cette intégration est nécessaire aussi pour le soin et l'éducation chrétienne des enfants, qui doivent être considérés comme les plus importants. Pour la communauté chrétienne, prendre soin de ces personnes n'est pas un affaiblissement de sa propre foi et du témoignage sur l'indissolubilité du mariage: dans cette sollicitude l'Église exprime plutôt sa charité.
85. Saint Jean-Paul II a offert un critère global, qui reste la base de l'évaluation de ces situations:
«Les pasteurs doivent savoir que, par amour de la vérité, ils ont l'obligation de bien discerner les diverses situations. Il y a en effet une différence entre ceux qui se sont efforcés avec sincérité de sauver un premier mariage et ont été injustement abandonnés, et ceux qui par une faute grave ont détruit un mariage canoniquement valide. Il y a enfin le cas de ceux qui ont contracté une seconde union en vue de l'éducation de leurs enfants, et qui ont parfois, en conscience, la certitude subjective que le mariage précédent, irrémédiablement détruit, n'avait jamais été valide»(FC, 84).
Il est donc du devoir des prêtres d'accompagner les personnes concernées sur la voie du discernement selon l'enseignement de l'Eglise et les orientations de l'évêque. Dans ce processus, il sera utile de faire un examen de conscience, à travers des moments de réflexion et de repentir.
Les divorcés remariés devraient se demander comment ils se sont comportés envers leurs enfants lorsque l'union conjugale est entrée en crise; s'il y a eu des tentatives de réconciliation; quelle est la situation du partenaire abandonné; quelles conséquences a la nouvelle relation sur le reste de la famille et de la communauté des fidèles; quel exemple elle offre aux jeunes qui se préparent pour le mariage. Une réflexion sincère peut renforcer la confiance dans la miséricorde de Dieu qui n'est refusée à personne.
En outre, on ne peut nier que, dans certaines circonstances «l'imputabilité et la responsabilité d'une action peuvent être diminuées ou annulées» (CEC, 1735) en raison de différents conditionnements. En conséquence, le jugement sur une situation objective ne doit pas conduire à un jugement sur l' «imputabilité subjective» (Conseil pontifical pour les Textes législatifs, Déclaration du 24 Juin 2000, 2a).
Dans des circonstances déterminées, les personnes trouvent de grandes difficultés à agir différemment. C'est pourquoi, tout en soutenant une règle générale, il est nécessaire de reconnaître que la responsabilité à l'égard d'actions ou de décisions déterminées ne sont pas les mêmes dans tous les cas. Le discernement pastoral, tout en tenant compte de la conscience correctement formée de la personne, doit prendre en charge ces situations. Les conséquences des actes, elles aussi, ne sont pas nécessairement les mêmes dans tous les cas.
86. Le parcours d'accompagnement et de discernement oriente ces fidèles vers la prise de conscience de leur situation devant Dieu. L'entretien avec le prêtre, au for interne, concourt à la formation d'un jugement correct sur ce qui entrave la possibilité d'une participation plus pleine à la vie de l'Église et sur les mesures qui peuvent la favoriser et la faire grandir. Étant donné que dans la loi elle-même, il n'y a pas de gradualité (cf. FC 34), ce discernement ne pourra jamais faire abstraction des exigences de vérité et de charité de l'Evangile proposées par l'Eglise.
Pour ce faire, les conditions nécessaires d'humilité, de réserve, d'amour pour l'Eglise et son enseignement, dans la recherche sincère de la volonté de Dieu et le désir de parvenir à une réponse plus parfaite à elle, devront être garanties.
21:24 | Lien permanent | Commentaires (0) | | | ![]() Facebook
Facebook
Journalisme: l'amour et la passion pour la vérité
Un journaliste est un chasseur de vérité
 Pour ceux qui aiment la communication et le journalisme, la recherche de la vérité est essentielle. C'est ce qu'attendent les lecteurs, les auditeurs ou les spectateurs.
Pour ceux qui aiment la communication et le journalisme, la recherche de la vérité est essentielle. C'est ce qu'attendent les lecteurs, les auditeurs ou les spectateurs.
Avec ces deux prochaines publications nommées Vatileaks 2 "Via Crucis" et "Avarizia", les auteurs Nuzzi et Fittipaldi ne servent nullement la cause de la vérité.
Il y a certes quelques vérités, mais partielles, et surtout bien des imprécisions, des mensonges et des demi-vérités. Dommage, car les scandales financiers au Vatican existent.
George Weigel, mondialement reconnu dans sa profession, n'avait-t-il pas avancé que les révélations médiatiques sur la pédophilie avaient aidé les victimes et rendu service à l'Eglise ?
Nuzzi: sa médiocrité nuit gravement à la qualité de la communication
Pour y remédier, la vérité est essentielle. Hélas, Nuzzi nuit gravement au noble métier de journaliste. Un tel spectacle, basé sur sensationnel et la vanité personnelle, ne peut guère aider l'ensemble de la profession.
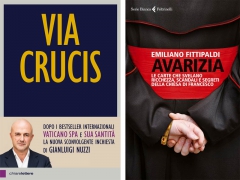
"Des publications de ce genre n’aident en aucune manière à clarifier et à établir la vérité. Au contraire, elles sèment la confusion et donnent lieu à des interprétations partielles et tendancieuses. Il faut absolument, insiste le Bureau de presse du Saint-Siège éviter de croire que cela puisse aider la mission du Saint-Père".
Père Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Siège
Quant à Francesca Chaouqui, elle tweete !
#coseserie Allora ragazzi, non ho intenzione di fare un circo di conferme o smentite. Quindi valga questo post... https://t.co/uX4Pf0a5AC
— Francesca Chaouqui (@FrancescaChaouq) 3 Novembre 2015
17:21 | Lien permanent | Commentaires (0) | | | ![]() Facebook
Facebook
Les évêques suisses pour l'homélie prononcée par les évêques, prêtres ou les diacres
Les évêques suisses pour l'homélie prononcée par les évêques, prêtres ou diacres

... pour les diacres et prêtres s’y ajoute la participation que leur confère le sacrement de l’ordre. Surtout durant la célébration de la Messe qu’il préside toujours à la place du Christ, la tête de l’Eglise, le prêtre témoigne que tout dans l’Eglise vient du Christ.
Un de ses mandats est de prononcer l’homélie lors de la Sainte Messe, durant laquelle on ne peut séparer la table de la Parole de la table du Pain.
Les évêques suisses: pour la promotion des laïcs laïcs et des prêtres prêtres
Lorsqu’il y a dilution et nivellement des spécificités des vocations et des profils professionnels, la pastorale des vocations perd, elle aussi, sa base. Il en résulte une confusion qui se traduit dans les faits par une « cléricalisation » de nombreux théologiens laïques et une « laïcisation » de nombreux prêtres. L’«Eglise cléricale» que le Concile Vatican II voulait dépasser en renouvelant la théologie de l’apostolat des laïcs se poursuit ainsi de façon inversée.
La collaboration entre prêtres, diacres et laïcs dans le cadre de la célébration de l'Eucharistie
Chers Frères dans la prêtrise et la diaconie, Chères Sœurs, chers Frères dans la pastorale,
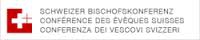
Les rapides changements dans la société que nous ressentons tous touchent aussi l’Eglise. Les catholiques pratiquent aujourd’hui leur foi différemment qu’il y a encore quelques décennies. Les jeunes prêtres sont devenus rares, le nombre de théologiennes et théologiens laïques recule également. Dans beaucoup d’endroits, les structures pastorales traditionnelles ne répondent plus aux exigences de notre temps.
Les diocèses relèvent ces défis et adaptent leurs structures pastorales, ce qui peut engendrer peur et insécurité chez de nombreux fidèles et agents pastoraux laïcs. Nous désirons, par le présent message, vous orienter et apporter notre soutien sur deux points que nous trouvons particulièrement importants et prioritaires : la célébration de l'Eucharistie et la collaboration entre prêtres, diacres et agents pastoraux laïcs.
On nous pose souvent à nous, évêques, des questions sur la Messe et sur la façon de la célébrer. Les gens sentent à l’évidence que la Messe est fondamentale. En effet, ce qui compte, en premier lieu, dans l’Eglise est la présence réelle du Christ. Nous allons à sa rencontre, nous l’annonçons Lui (et non nous-mêmes), car il est vrai Dieu qui se fait Homme. Et il reste présent parmi ses amis et amies sur- tout par l’Eucharistie. Il est extrêmement important que nous nous remettions régulièrement ce cadeau à l’esprit et que nous en vivions.
L’Eglise catholique croit que ce qui était pain et vin cesse d’être pain et vin lors de la célébration de la Messe: ils deviennent et demeurent corps et sang du Christ. Nous prenons ainsi au sens littéral les étonnantes paroles du Christ : « Ceci est mon corps .... Ceci est mon sang. »
Effectivement, ce sont des paroles surprenantes, mais le christianisme ne nous intéresserait pas s’il ne provoquait l’étonnement. Ces paroles doivent surtout nous étonner nous, prêtres : avons-nous vraiment reçu nous-mêmes la capacité de transformer du pain et du vin en corps et sang du Christ ? Non, nous n’en sommes pas capables par nous-mêmes et c’est pourquoi il faut un don de Dieu : le sacrement de l’ordre.
Il est conféré par les évêques, successeurs des apôtres qui, de leur côté, ont reçu cette grâce pour la transmettre. Lorsqu’un homme reçoit ce sacrement et donc qu’il est ordonné prêtre, il lui est possible de réaliser quelque chose qui le dépasse complètement : il peut dès ce moment prêter sa bouche (et toute sa vie) au Christ et dire en son nom : « Ceci est mon corps » ou « Tes péchés te sont pardonnés ».
Aucun prêtre ne peut remplir cette fonction seulement parce qu’il serait parfait. D’une part, nous savons que nous ne le sommes pas et, d’autre part, ce que nous faisons en tant que prêtres nous dépasse infiniment ! Même en étant mille fois meilleurs, nous aurions toujours besoin de l’ordination. Ce que nous donnons ne vient pas de nous et ce n’est pas non plus pour nous que les gens viennent à l’église : c’est le Christ qui se donne à nous dans l’Eucharistie !
Jésus est présent dans l’Eucharistie et reste présent parmi ses amies et ses amis avec son corps ressuscité, discret, caché dans les dons du pain et du vin pour que nous vivions de lui. Ceci est le cœur de la vie de l’Eglise, son trésor véritable ! Toute la vie de l’Eglise tourne autour de cette perle à la- quelle nous, prêtres, prêtons notre voix et consacrons notre vie.
Si la pastorale et la catéchèse étaient, il y a cinquante ans, l’affaire presque exclusive des prêtres et des religieuses, elles sont aujourd’hui confiées de plus en plus et surtout à des diacres et des agents pastoraux laïcs. C’est une évolution encourageante qui permet à beaucoup de charismes différents et complémentaires de donner le témoignage d’un seul corps constitué de multiples membres (cf. 1 Cor 12, 1-11 et LG 7). Nous, évêques, en sommes reconnaissants et apprécions les riches services que les laïcs, et notamment les femmes, rendent dans tous les domaines de la vie de l’Eglise.
Cette évolution entraîne cependant aussi quelques difficultés. Celles-ci se manifestent de façons différentes dans les diocèses en Suisse du fait que les traditions et mentalités, les cursus de forma- tion et les ressources financières et, partant, les possibilités d’engagement dans les diocèses sont très différents. Nous devons apprendre et expérimenter cette collaboration nouvelle entre prêtres et laïcs, dans l'esprit de la théologie des ministères.
Nous nous trouvons au cœur de ce processus qui se déroule différemment en Suisse alémanique qu’en Suisse romande et au Tessin. Ceci apparaît plus clairement là où des agents pastoraux laïcs œuvrent en pastorale avec un contrat de travail. Les en- jeux touchent cependant tous les engagements professionnels en pastorale, y compris chez les diacres. Car, en fin de compte, hier comme aujourd’hui, le ministère du prêtre demeure déterminant dans la charge pastorale.
Il en résulte des difficultés de délimitation et d’identité personnelle. Cet élément ainsi que les profondes mutations dans les paroisses, unités pastorales, secteurs pastoraux et services catégoriels se répercutent dans différentes initiatives, revendications, plaintes et également publications.
Dans son discours remis aux évêques suisses le 1er décembre 2014, le Pape François écrit à propos du travail professionnel ou bénévole des laïcs dans l’Eglise :
«La mission des laïcs dans l’Église a, en effet, une grande place, car ils contribuent à la vie des paroisses et des communautés chrétiennes, que ce soit comme professionnels ou comme volontaires. Il est bon de valoriser et de soutenir leur engagement, tout en maintenant bien la distinction entre le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel. Sur ce point j’encourage à poursuivre la formation des baptisés sur les vérités de la foi et leur implication dans la vie liturgique, paroissiale, familiale et sociale, en choisissant avec soin les formateurs. Vous permettrez ainsi aux laïcs de se situer en vérité dans l’Église, d’y prendre leur place et de faire fructifier la grâce reçue au baptême, pour marcher ensemble vers la sainteté et pour le bien de tous.»
Cléricalisation des laïcs et laïcisation des prêtres
L’amalgame des fonctions de prêtres, diacres et agents pastoraux laïcs, que l’on constate ici ou là, ne se justifie ni au niveau biblique ni en théologie sacramentelle. Il ne mène à rien dans la pratique, car il ne permet pas de vivre la complémentarité dans la collaboration entre les différents engagements en pastorale.
Lorsqu’il y a dilution et nivellement des spécificités des vocations et des profils professionnels, la pastorale des vocations perd, elle aussi, sa base. Il en résulte une confusion qui se traduit dans les faits par une « cléricalisation » de nombreux théologiens laïques et une « laïcisation » de nombreux prêtres. L’«Eglise cléricale» que le Concile Vatican II voulait dépasser en renouvelant la théologie de l’apostolat des laïcs se poursuit ainsi de façon inversée.
Le principe de service prévalant dans le Nouveau Testament constitue le fondement de tout ministère dans l’Eglise. Tout ministère est service. Nous rappelons par la même occasion que les ministères des prêtres, des diacres et des laïcs diffèrent fondamentalement les uns des autres même s’ils sont tous au service de l’édification du Corps du Christ3: le corps a de nombreux membres mais tous n’ont pas la même fonction (cf. Rom 12,4).
La structure sacramentelle de l’Eglise fait que tous les fidèles participent ensemble, par le sacrement du baptême et de la confirmation, au triple ministère du Christ (prêtre, roi, prophète) ; pour les diacres et prêtres s’y ajoute la participation que leur confère le sacrement de l’ordre. Surtout durant la célébration de la Messe qu’il préside toujours à la place du Christ, la tête de l’Eglise, le prêtre témoigne que tout dans l’Eglise vient du Christ.
Cette mission et ce rôle du prêtre sont toujours indispensables aujourd’hui, même si les conditions ont changé. Un de ses mandats est de prononcer l’homélie lors de la Sainte Messe, durant laquelle on ne peut séparer la table de la Parole de la table du Pain.
Nous avons conscience des limites que nous imposons dans le quotidien de la vie des communautés paroissiales par les normes que nous fixons. Nous savons que les fidèles ont souvent des attentes, auxquelles nous ne pouvons pas répondre, et nous savons également que les prêtres, tout comme les théologiennes/théologiens laïques, ont parfois un emploi du temps surchargé.
C’est pourquoi nous souhaitons vous encourager à déléguer les tâches qui ne relèvent pas du sacrement de l’ordination ou de la mission particulière donnée par l’évêque (missio canonica). Il faut pour cela de la confiance. Mais ainsi la vie de l’Eglise sera celle du peuple de Dieu, à laquelle tous ses membres peuvent et doivent contribuer à travers leurs charismes et services, dans le cadre de la structure sacramentelle et du droit de l’Eglise.
Nous, évêques, vous remercions de votre ministère dans nos diocèses, et nous vous souhaitons de l’accomplir sous la bénédiction de Dieu.
Fribourg, le 2 septembre 2015
Les Evêques suisses
14:40 | Lien permanent | Commentaires (1) | | | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 02 novembre 2015
Vatileaks le retour: un prélat et une laïque arrêtés au Vatican

Vatileaks le retour: Francesca Chaouqui et un prélat arrêtés au Vatican
(photo) Francesca Chaouqui, une femme assez sulfureuse au service du Pape et du Saint-Siège, a beaucoup joué sur son image "people".
Le Magazine Crux l'annonçait la semaine dernière: le Vatican se préparait à des nouvelles révélations sur les finances du Vatican.
Deux livres allaient être publiés, notamment par le journaliste Nuzzi, ancien membre des services secrets, lié au premier Vatileaks sous le règne de Benoît XVI.
Le majordome de Benoît XVI lui avait transmis des documents volés sur son bureau.
The Vatican is bracing for new revelations of financial mismanagement https://t.co/qezFmzyiAl
— Crux (@Crux) 29 Octobre 2015
Le Vatican a communiqué l'arrestation d'un prêtre, membre de l'Opus Dei (voir communiqué), et d'une laïque qui auraient transmis des informations strictement réservées.
Le prêtre Lucio Angel Vallejo Balda, désormais en prison au Vatican, était secrétaire de la Préfecture pour les affaires économiques du Saint-Siège avant de devenir le n°2 de la Commission pontificale de référence sur l’organisation de la structure économique et sociale du Saint-Siège, créée par le pape François le 20 juillet 2013. Elle fut remplacée par le Secrétariat pour l’Économie présidé par le cardinal George Pell.
Vatileaks le retour: l'un contre Benoît XVI, l'autre pour François
Notons que si la couverture médiatique du premier Vatileaks cherchait à mettre en cause le Pape Benoît XVI, ce remake renforce la volonté du Pape François. Curieux comme Benoît XVI fut attaqué pour sa gestion et François loué pour sa lutte contre la corruption. Les deux sont pourtant mains dans la mains. Certains avaient avancé, à tort, que le Pape Benoît XVI avait renoncé à cause de ces affaires.
UN PRÉLAT ET UNE LAÏQUE ARRÊTÉS PAR LE VATICAN APRÈS LA FUITE DE DOCUMENTS SUR LES FINANCES DU PETIT ETAT
Vatican - le 02/11/2015 | Par Agence I.Media
Le secrétaire de la Préfecture pour les affaires économiques du Saint-Siège, le prélat espagnol Mgr Lucio Angel Vallejo Balda, et l’Italienne Francesca Immacolata Chaouqui ont été arrêtés le 1er novembre 2015 au Vatican après le vol de données dans l’ordinateur du contrôleur général des finances du petit Etat, a indiqué le lendemain le Saint-Siège.
Ils sont accusés d’avoir divulgué des documents comptables dont certains devraient être publiés dans deux ouvrages polémiques à paraître en Italie.
 (Radio Vatican ) Au Vatican, deux personnes ont été convoquées et interrogées les 31 octobre et 1er novembre dans le cadre de l’enquête ouverte il y a quelques mois par la Gendarmerie vaticane à propos du vol et de la diffusion d’informations et de documents confidentiels. Il s’agit d’un prélat espagnol, Mgr Lucio Angel Vallejo Balda, de l’Opus Dei et d’une avocate italienne Francesca Chaouqui, respectivement ancien secrétaire et ancien membre de la COSEA, une commission créée par le Pape François dès le mois de juillet 2013.
(Radio Vatican ) Au Vatican, deux personnes ont été convoquées et interrogées les 31 octobre et 1er novembre dans le cadre de l’enquête ouverte il y a quelques mois par la Gendarmerie vaticane à propos du vol et de la diffusion d’informations et de documents confidentiels. Il s’agit d’un prélat espagnol, Mgr Lucio Angel Vallejo Balda, de l’Opus Dei et d’une avocate italienne Francesca Chaouqui, respectivement ancien secrétaire et ancien membre de la COSEA, une commission créée par le Pape François dès le mois de juillet 2013.
Chargée de l’organisation des structures économiques et administratives du Saint-Siège, cette Commission avait été dissoute à la fin de son mandat. A la suite de ces interrogatoires, ces deux personnes ont été arrêtées. Ce lundi 2 novembre, le bureau du Promoteur de Justice a remis en liberté Madame Chaouqui, qui a accepté de collaborer avec les enquêteurs, tandis que le cas de Mgr Vallejo Balda, est à l’étude. Cette affaire intervient alors que deux journalistes italiens doivent publier cette semaine des ouvrages qui promettent des révélations sur des scandales et les affaires financières du Saint-Siège. L’un des deux, Gianluigi Nuzzi, avait, pendant le pontificat de Benoît XVI en 2012 rassemblé et publié des données et des documents réservés à l’origine de l’affaire surnommée Vatileaks.
"Grave trahision"
Dans un communiqué du Bureau de presse, le Saint-Siège rappelle que ces publications sont le fruit d’une grave trahison de la confiance accordée par le Saint-Père. Les auteurs de ces livres tirent profit d’un acte illicite qui pourrait avoir des répercussions juridiques et éventuellement pénales. Le Bureau du Promoteur de Justice n’exclut d’avoir recours, si nécessaire, à la coopération internationale. Des publications de ce genre n’aident en aucune manière à clarifier et à établir la vérité. Au contraire, elles sèment la confusion et donnent lieu à des interprétations partielles et tendancieuses. Il faut absolument, insiste le Bureau de presse du Saint-Siège éviter de croire que cela puisse aider la mission du Saint-Père.
Selon la presse italienne, un vol de données aurait été perpétré sur l’ordinateur du contrôleur général des finances du Vatican, l’italien Libero Milone, dans son bureau situé non loin de la place Saint-Pierre. Nommé par le Souverain Pontife le 5 juin dernier pour la réforme des finances, Libero Milone est chargé de l’audit des comptes de l’ensemble des administrations du Vatican. Un procès par le tribunal du Vatican n’est pas exclu.
(RF)
21:16 | Lien permanent | Commentaires (6) | | | ![]() Facebook
Facebook
Arrestation au Vatican d'un prêtre de l'Opus Dei: communiqué
 Différents moyens de communication ont demandé à l'office de communication italien de l'Opus Dei des informations concernant l'arrestation de Mons.Lucio Angel Vallejo Balda. Nous sommes fort surpris et exprimons notre douleur pour cette nouvelle.
Différents moyens de communication ont demandé à l'office de communication italien de l'Opus Dei des informations concernant l'arrestation de Mons.Lucio Angel Vallejo Balda. Nous sommes fort surpris et exprimons notre douleur pour cette nouvelle.
L'Oeuvre ne dispose d'aucune information sur cette affaire. Si l'accusation se confirmait, cela serait particulièrement douloureux pour la mal causé à l'Eglise.
Mons.Vallejo appartient à la Société Sacerdotale de la Sainte Croix, association de prêtres intrinsèquement unie à l'Opus Dei, qui n'a pas le droit d'intervenir ni dans le ministère pastoral ni dans le travail que ses associés fournissent, soit dans leurs diocèses soit auprès du Saint-Siège. La mission de l'association est l'accompagnement spirituel de ses membres.
Mons.Vallejo fut appelé à travailler à Rome pour le Saint-Siège avec l'accord de son évêque (diocèse de Astorga, Espagne). La prélature de l'Opus Dei n'est pas intervenu et n'a pas connu cette décision avant sa révélation publique: de fait, les uniques supérieurs de Mons. Vallejo sont ceux du Saint-Siège et l'évêque du diocèse de son incardination (Astorga)
Ufficio Comunicazione della prelatura dell’Opus Dei in Roma
(traduit de l'italien par le Suisse Romain)
20:49 | Lien permanent | Commentaires (0) | | | ![]() Facebook
Facebook

