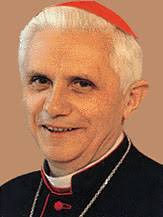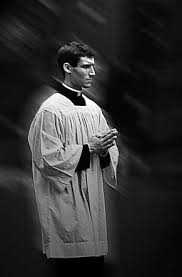Congrégation pour la doctrine de la foi.
Art. 2
§ 1. Les délits contre la foi, dont il s'agit à l'art. 1, sont l'hérésie, l'apostasie et le schisme selon la norme des cann. 751 et 1364 du Code de droit canonique et des cann. 1436 et 1437 du Code des Canons des Églises orientales.
§ 2. Dans les cas dont il s'agit au § 1, il revient selon la norme du droit à l'Ordinaire ou au Hiérarque de remettre, le cas échéant, l'excommunication latae sententiae et de mener le procès judiciaire en première instance, ou extrajudiciaire par décret, restant sauf le droit de faire appel ou de recourir à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.
Art. 3
§ 1. Les délits les plus graves contre la sainteté du très auguste Sacrifice et sacrement de l'Eucharistie réservés au jugement de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi sont :
1° le détournement ou la conservation à une fin sacrilège, ou la profanation des espèces consacrées dont il s'agit au can. 1367 du Code de droit canonique et du can. 1442 du Code des Canons des Églises orientales ;
2° la tentative de célébration liturgique du Sacrifice eucharistique dont il s'agit au can. 1378 § 2 n. 1 du Code de droit canonique ;
3° la simulation de la célébration liturgique du Sacrifice eucharistique dont il s'agit au can. 1379 du Code de droit canonique et du can. 1443 du Code des Canons des Églises orientales ;
4° la concélébration du Sacrifice eucharistique interdite par le can. 908 du Code de droit canonique et du can. 702 du Code des Canons des Églises orientales, dont il s'agit au can. 1365 du Code de droit canonique et du can. 1440 du Code des Canons des Églises orientales, avec des ministres des communautés ecclésiales qui n'ont pas la succession apostolique et ne reconnaissent pas la dignité sacramentelle de l'ordination sacerdotale.
§ 2. Est également réservé à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi le délit consistant à consacrer à une fin sacrilège une seule matière ou les deux au cours de la célébration eucharistique ou en dehors d'elle. Celui qui commet ce délit sera puni selon la gravité du crime, sans exclure le renvoi ou la déposition.
Art. 4
§ 1. Les délits les plus graves contre la sainteté du sacrement de pénitence réservés au jugement de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi sont :
1° l'absolution du complice dans le péché contre le sixième commandement du Décalogue, dont il s'agit au can. 1378 § 1 du Code de droit canonique et au can. 1457 du Code des Canons des Églises orientales ;
2° la tentative d'absolution sacramentelle ou l'écoute interdite de la confession dont il s'agit au can. 1378 § 2, 2° du Code de droit canonique ;
3° la simulation d'absolution sacramentelle dont il s'agit au can. 1379 du Code de droit canonique et du can. 1443 du Code des Canons des Églises orientales ;
4° la sollicitation au péché contre le sixième commandement du Décalogue dans l'acte ou à l'occasion ou au prétexte de la confession dont il s'agit au can. 1387 du Code de droit canonique et du can. 1458 du Code des Canons des Églises orientales, si elle est dirigée vers le péché avec le confesseur lui-même ;
5° la violation directe ou indirecte du secret sacramentel dont il s'agit au can. 1388 § 1 du Code de droit canonique et du can. 1456 § 1 du Code des Canons des Églises orientales.
§ 2. Restant sauf ce qui est disposé au § 1 n. 5, est aussi réservé à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi le délit grave consistant à enregistrer, par n'importe quel moyen technique, ou à divulguer avec malice par les moyens de communication sociale, des choses dites par le confesseur ou par le pénitent au cours de la confession sacramentelle réelle ou simulée. Celui qui commet ce délit sera puni selon la gravité du crime, sans exclure le renvoi ou la déposition s'il est clerc.
Art. 5
Est aussi réservé à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi le délit grave de tentative d'ordination sacrée d'une femme :
1° restant sauf ce qui est disposé par le can. 1378 du Code de droit canonique, tant celui qui attente la collation de l'ordre sacré que la femme qui attente la réception de l'ordre sacré, encourent l'excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique ;
2° si celui qui attente de conférer l'ordre sacré à une femme ou si la femme qui attente de le recevoir sont chrétiens sujets du Code des Canons des Églises orientales, restant sauf ce qui est disposé par le can. 1443 du même Code, ils seront punis de l'excommunication majeure dont la rémission est également réservée au Siège Apostolique ;
3° si le coupable est clerc, il pourra être puni du renvoi ou de la déposition.
Art. 6
§ 1. Les délits les plus graves contre les mœurs réservés au jugement de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi sont :
1° le délit contre le sixième commandement du Décalogue commis par un clerc avec un mineur de moins de dix-huit ans ; est ici équiparée au mineur la personne qui jouit habituellement d'un usage imparfait de la raison ;
2° l'acquisition, la détention ou la divulgation, à une fin libidineuse, d'images pornographiques de mineurs de moins de quatorze ans de la part d'un clerc, de quelque manière que ce soit et quel que soit l'instrument employé.
§ 2. Le clerc qui accomplit les délits dont il s'agit au § 1 sera puni selon la gravité du crime, sans exclure le renvoi ou la déposition.
Art. 7
§ 1. Restant sauf le droit de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi de déroger à la prescription cas par cas, l'action criminelle relative aux délits réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi est prescrite au bout de vingt ans.
§ 2. La prescription commence à courir selon la norme du can. 1362 § 2 du Code de droit canonique et du can. 1152 § 3 du Code des Canons des Églises orientales. Mais pour le délit dont il s'agit à l'art. 6 § 1 n. 1, la prescription commence à courir du jour où le mineur a eu dix-huit ans.
Seconde Partie
NORMES PROCÉDURALES
Titre I
Constitution et compétence du Tribunal
Art. 8
§ 1. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi est le Tribunal Apostolique Suprême pour l'Église latine ainsi que pour les Églises orientales catholiques en matière de jugement des délits définis dans les articles précédents.
§ 2. Ce Tribunal Suprême connaît aussi des autres délits pour lesquels le coupable est accusé par le Promoteur de Justice, en raison d'un lien de personne et de complicité.
§ 3. Les sentences de ce Tribunal Suprême, prononcées dans les limites de sa compétence propre, ne sont pas soumises à l'approbation du Souverain Pontife.
Art. 9
§ 1. Les juges de ce Tribunal Suprême sont, de plein droit, les Pères de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.
§ 2. Le collège des Pères est présidé par le premier d'entre eux, le Préfet de la Congrégation ; en absence de Préfet ou s'il est empêché, le Secrétaire de la Congrégation en accomplit l'office.
§ 3. Il appartient au Préfet de la Congrégation de nommer également d'autres juges stables ou délégués.
Art. 10
Il est nécessaire que soient nommés juges des prêtres d'âge mûr, titulaires d'un doctorat en droit canonique, de bonnes mœurs, particulièrement distingués par la prudence et l'expérience juridique, même s'ils exercent simultanément l'office de juge ou de consulteur auprès d'un autre Dicastère de la Curie romaine.
Art. 11
Pour présenter et soutenir l'accusation, est constitué un Promoteur de Justice, qui doit être prêtre, titulaire d'un doctorat en droit canonique, de bonnes mœurs, remarquable par sa prudence et sa compétence juridique, remplissant sa charge à tous les degrés de jugement.
Art. 12
Pour les charges de Notaire et de Chancelier, des prêtres sont désignés, Officiaux de cette Congrégation ou extérieurs à elle.
Art. 13
Tient lieu d'Avocat et de Procureur un prêtre titulaire d'un doctorat en droit canonique qui est approuvé par le Président du collège.
Art. 14
Par ailleurs, dans les autres Tribunaux, pour les causes dont il s'agit dans les présentes normes, seuls des prêtres peuvent remplir validement les charges de Juge, de Promoteur de Justice, de Notaire et d'Avocat.
Art. 15
Restant sauf ce qui est disposé par le can. 1421 du Code de droit canonique et par le can. 1087 du Code des Canons des Églises orientales, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi peut légitimement dispenser de l'obligation de prendre un prêtre ou un docteur en droit canonique.
Art. 16
Claque fois que l'Ordinaire ou le Hiérarque vient à connaissance, au moins vraisemblable, d'un délit grave, une fois menée l'enquête préliminaire, il le signale à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, laquelle, si elle ne s'attribue pas la cause en raison de circonstances particulières, ordonne à l'Ordinaire ou au Hiérarque de procéder ultérieurement, restant cependant sauf, le cas échéant, le droit de faire appel contre la sentence de premier degré seulement auprès du Tribunal Suprême de cette même Congrégation.
Art. 17
Si le cas est déféré directement à la Congrégation, sans que soit menée l'enquête préliminaire, les préliminaires du procès, qui reviennent d'après le droit commun à l'Ordinaire ou au Hiérarque, peuvent être accomplis par la Congrégation elle-même.
Art. 18
Dans les causes qui lui sont légitimement déférées, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi peut convalider les actes, restant sauf le droit de la défense, si des Tribunaux inférieurs agissant par mandat de la même Congrégation ou selon l'art. 16 ont violé des lois purement processuelles.
Art. 19
Restant sauf le droit de l'Ordinaire ou du Hiérarque, dès le début de l'enquête préliminaire, d'imposer ce qui est prévu par le can. 1722 du Code de droit canonique et par le can. 1473 du Code des Canons des Églises orientales, le Président en exercice du Tribunal, sur instance du Promoteur de Justice, possède le même pouvoir aux mêmes conditions déterminées par lesdits canons.
Art. 20
Le Tribunal Suprême de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi juge en seconde instance :
1° les causes jugées en première instance par les Tribunaux inférieurs ;
2° les causes tranchées en première instance par ce même Tribunal Apostolique Suprême.
Titre II
L'ordre judiciaire
Art. 21
§ 1. Les délits graves réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi doivent être poursuivis par procès judiciaire.
§ 2. Toutefois, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi peut légitimement :
1° dans des cas particuliers, décider d'office ou sur instance de l'Ordinaire ou du Hiérarque de procéder par le décret extrajudiciaire dont il s'agit au can. 1720 du Code de droit canonique et au can. 1486 du Code des Canons des Églises orientales, en tenant compte, toutefois, que les peines expiatoires perpétuelles ne sont infligées que par mandat de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi ;
2° déférer directement les cas les plus graves à la décision du Souverain Pontife, pour le renvoi de l'état clérical ou la déposition avec dispense de la loi du célibat, quand le délit est manifestement constaté et après avoir accordé au coupable la possibilité de se défendre.
Art. 22
Pour connaître d'une cause, le Préfet constituera un collège de trois ou cinq juges.
Art. 23
Si, en instance d'appel, le Promoteur de Justice présente une accusation sensiblement modifiée, ce Tribunal Suprême peut la recevoir et en juger, comme si elle était en première instance.
Art. 24
§ 1. Dans les causes pour les délits dont il s'agit à l'art. 4 § 1, le Tribunal ne peut rendre public le nom du plaignant ni à l'accusé ni même à son avocat, à moins que le plaignant ait donné son consentement explicite.
§ 2. Le même Tribunal doit évaluer avec une particulière attention la crédibilité du plaignant.
§ 3. Toutefois, il faut veiller à éviter absolument tout risque de violation du secret sacramentel.
Art. 25
S'il se présente une question incidente, le Collège décidera de la chose par décret dans les plus brefs délais.
Art. 26
§ 1. Restant sauf le droit de faire appel à ce Tribunal Suprême, quand l'instance sera parvenue à son terme de quelque manière que ce soit dans un autre Tribunal, tous les actes de la cause seront transmis d'office à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi dans les meilleurs délais.
§ 2. Le droit du Promoteur de Justice de la Congrégation de contester la sentence commence à courir du jour où la sentence de première instance a été notifiée à ce même Promoteur.
Art. 27
Contre les actes administratifs particuliers émis ou approuvés par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi dans le cas des délits réservés, le recours est admis, par présentation dans le délai péremptoire de soixante jours utiles à la Congrégation ordinaire (ou Feria IV) de ce même Dicastère, laquelle juge du fond et de la légitimité, étant exclu tout recours ultérieur dont il s'agit à l'art. 123 de la Constitution Apostolique Pastor bonus.
Art. 28
Une chose est tenue pour jugée :
1° si la sentence a été prononcée en seconde instance :
2° si l'appel contre la sentence n'a pas été interjeté en l'espace d'un mois ;
3° si l'instance est périmée au degré d'appel, ou si on y a renoncé ;
4° s'il a été prononcé une sentence selon la norme de l'art. 20.
Art. 29
§ 1. Les frais judiciaires sont réglés selon ce qu'établit la sentence.
§ 2. Si le coupable ne peut régler les frais, ceux-ci seront réglés par l'Ordinaire ou le Hiérarque de la cause.
Art. 30
§ 1. Les causes de ce genre sont soumises au secret pontifical.
§ 2. Quiconque viole le secret ou, par dol ou négligence grave, cause un autre dommage à l'accusé ou aux témoins, sera, sur instance de la partie lésée ou même d'office, puni de peines adaptées par le Tribunal supérieur.
Art. 31
Dans ces causes, conjointement aux prescriptions de ces normes auxquelles sont tenus tous les Tribunaux de l'Église latine et des Églises orientales catholiques, on doit appliquer aussi les canons de chacun des deux Codes au sujet des délits et des peines ainsi que du procès pénal.
[Texte original: Latin - Traduction française distribuée par la salle de presse du Saint-Siège]